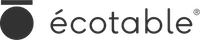Quel est le rôle de notre alimentation dans la déforestation mondiale ?

Alors que la loi anti-déforestation adoptée par le Parlement Européen en avril 2023 promettait de réduire significativement l’impact de notre alimentation sur la couverture forestière mondiale, le report de son application à 2026 inquiète les défenseurs de la cause environnementale. Et pour cause : l'agriculture est aujourd’hui la première cause de déforestation dans le monde.
L’importance des “poumons verts” de la planète
Les forêts sont essentielles pour réguler le climat et la qualité de l’air grâce à la photosynthèse exercée par les arbres. On estime en effet que les forêts absorbent près de 2 milliards de tonnes de CO₂ chaque année, soit 5% de nos émissions globales, tout en rejetant de l’oxygène. Les forêts dites «primaires » ou anciennes sont d’autant plus bénéfiques qu’il a été démontré que les plus grands spécimens d’arbres absorbent 60 à 70 fois plus de CO2 que les arbres de petite taille.
Au-delà de leur rôle climatique, les environnements sylvestres abritent 80 % de la biodiversité mondiale. Ils forment des écosystèmes complexes où chaque espèce, des bactéries jusqu’aux grands mammifères, joue un rôle dans le bon fonctionnement du réseau trophique (l'ensemble des relations entre les chaînes alimentaires dans un écosystème naturel). De plus, les sols des forêts filtrent naturellement l’eau, et permettent de réduire la pollution plus efficacement que ne le font les sols d’exploitations agricoles. Les couvertures formées par les arbres offrent également une protection contre les catastrophes naturelles, comme l’ont par exemple démontré les mangroves en Indonésie lors du tsunami de 2018.
La forêt est aussi essentielle pour des questions de sécurité alimentaire, car certaines populations en dépendent pour subvenir à leurs besoins, grâce à la fertilité de ses sols et à sa capacité à réguler les cycles hydrologiques. Enfin, on reconnaît aussi aujourd’hui les liens entre la destruction de certaines forêts tropicales et la transmission de maladies infectieuses aux hommes par certains mammifères et insectes. La perturbation des écosystèmes augmente ainsi les risques d’épidémies. Le bien-être des forêts est donc en lien direct avec des enjeux de santé globale, et les services écosystémiques qu’elle rend sont nombreux, ce qui en fait une des solutions pour atténuer la crise climatique.
L’alimentation, une des premières causes de déforestation mondiale
L’un des principaux moteurs de la déforestation aujourd’hui est notre système alimentaire. La production de soja, d’huile de palme, de cacao, de café ou encore d’avocat repose en majeure partie sur des pratiques agricoles intensives et non durables, qui entraînent le défrichement de vastes zones forestières.
Voici une liste non-exhaustive des aliments les plus problématiques à cet égard :
- Le soja : Au niveau mondial, seulement 6% de la production de soja est destinée à l’alimentation humaine. En Europe, 87 % du soja importé sert à l’alimentation animale, et a contribué indirectement à la destruction d’une surface équivalente à celle du Portugal en 15 ans. Ce soja est utilisé en premier lieu dans les élevages de volaille. L’élevage de saumon arrive aujourd’hui en deuxième position. Par ailleurs, l'élevage bovin est aussi responsable de déforester l'Amazonie, notamment au Brésil, où des hectares entiers de forêt sont défrichés pour le pâturage des animaux. On estime par exemple qu'en 2021, que la production viande de boeuf était responsable d'environ 75% de la déforestation en Amazonie.
- L’huile de palme : Selon Amnesty International, elle est présente dans 50 % des produits vendus en supermarché. Elle est tragiquement connue pour son rôle majeur dans la déforestation en Asie du Sud-Est, où le modèle économique de certains pays s’est grandement développé sur cette culture agricole rentable. En Indonésie par exemple, la culture de palmiers à huile aurait détruit 85% de la forêt primaire de l'île de Sumatra. Malgré des tentatives de régulation pour freiner cette déforestation massive, la demande en huile de palme de la part du secteur agroalimentaire mais aussi pour la production de carburant continue de croître. Aujourd'hui, l'huile de palme représente environ 40% de la consommation globale d’huiles végétales.
- Le cacao : Il est la première cause de destruction forestière en Afrique de l’Ouest. Selon l’ONG Mighty Earth, l’équivalent de 15 000 terrains de football auraient été détruits en Côte d’Ivoire et au Ghana en 2018. La France importe aujourd’hui presque 440 000 tonnes de cacao chaque année, mais reste loin derrière la consommation suisse, britannique ou encore belge.
Pour en savoir plus, retrouvez notre article sur le chocolat ici.
- Le café : Sa production nécessite aujourd’hui environ 11 millions d’hectares dans une cinquantaine pays tropicaux, soit l’équivalent de la surface de l'île de Cuba. L’UE est le plus gros importateur de café et serait responsable de 44% de la déforestation liée au café.
Notre article à propos du café ici.
- L’avocat : L’explosion de sa demande au niveau mondial a entraîné un triplement de la production mondiale en un peu plus de 20 ans. Sa culture est particulièrement problématique au Mexique, notamment dans l’État du Michoacán, à l’ouest du pays, où les plantations illégales d’avocats se multiplient. Des groupes armés mettent feu à des forêts entières pour les remplacer par des plantations dans ces zones montagneuses. 25 000 hectares de forêt seraient ainsi défrichés chaque année.
Même si chacune de ces cultures n’est pas intrinsèquement destructrice, ce sont avant tout leurs méthodes de production actuelles, en majorité intensives, qui posent problème. La demande croissante pour ces produits au niveau mondial exacerbe ces dynamiques, mais il existe des alternatives pour réduire son impact. Manger moins de viande et de poissons issus de l'aquaculture pour réduire sa consommation indirecte de soja peut être une solution pour agir, tout comme privilégier du cacao, du café ou des huiles végétales issues du commerce équitable. La certification Fairtrade intègre notamment des exigences poussées en matière de protection des forêts et de la biodiversité. Cependant, attention, la certification d’huile de palme durable “RSPO” reste, elle, controversée à ce jour. Elle est notamment accusée de défendre les intérêts des groupes agroindustriels de production d’huile de palme, au dépend des droits environnementaux et humains.
Toutefois, au-delà des choix de produits plus durables qui peuvent être faits par les consommateurs, la réglementation sur l’importation de produits alimentaires engendrant de telles pratiques reste primordiale.

Crédit photo : Delightin Dee
Le règlement européen anti-déforestation : reculer pour mieux sauter ?
Les forêts situées sur le territoire européen sont déjà en partie protégées par les directives “Oiseaux” et “Habitats”, même si leur application et leur portée reste à questionner. Toutefois, rien jusqu’ici ne permettait de freiner la déforestation générée dans des pays tiers par la consommation des États membres. Face à ces enjeux, le Parlement et le Conseil européens ont adopté en 2023 un règlement pour freiner la déforestation importée dans l'Union européenne. Cette législation interdit la commercialisation de produits issus de zones déboisées après le 31 décembre 2020, et cible notamment le soja, l’huile de palme, le cacao, le café, le bois, et la viande bovine. Les entreprises devront également garantir la transparence dans la traçabilité des produits, pour pouvoir prouver que leurs chaînes d’approvisionnement ne contribuent pas à la destruction des forêts hors Union Européenne.
Bien que ce vote au Parlement européen représente une avancée majeure pour lutter contre la déforestation issue de notre alimentation, son application a été repoussée au 30 décembre 2025 pour les grosses entreprises, et à juin 2026 pour les plus petites entreprises. Ceci faisant suite au fort lobbying d’agro-industriels et de sylviculteurs auprès du Parlement européen.
Le délai avec lequel la législation européenne répond à cette destruction massive de notre patrimoine sylvicole soulève de fortes critiques. Il pourrait toutefois aussi permettre d’offrir l’opportunité d’instaurer des mesures d’accompagnement pour les producteurs, car la législation pose aussi des questions éthiques et de rémunération dans les pays exportateurs, que le mouvement Fair Trade tente notamment d’endiguer. Cependant, le lien direct entre la déforestation et notre alimentation rappelle encore une fois les limites de notre système agro-industriel actuel, et la lutte contre la déforestation ne peut être dissociée d'un changement plus global dans nos manières de consommer. Les forêts sont en effet au cœur des solutions basées sur la nature face à la crise climatique.