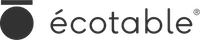Le bio français et le bio d’Espagne, c’est la même chose ?

Ah, le bio ! Le label le plus connu en matière alimentaire, qui nous promet des aliments sains, des pratiques agricoles respectueuses et une conscience tranquille en faisant nos courses. Aujourd’hui, la France est le deuxième pays qui consomme le plus de bio en Europe, derrière l’Allemagne. A elle seule, elle représente 26,8 % du marché Européen.
Mais derrière ce succès apparent d'où vient tout ce bio que nous consommons ? Une grande partie provient d'autres pays, notamment d’Espagne, principal fournisseur de fruits et légumes bio sur nos étals. Alors, le bio espagnol parfois qualifié de “faux bio” est-il équivalent au bio français ? Dans cet article nous allons tenter de comprendre ce que ce label signifie réellement d’un pays à l’autre.
L’origine de l'agriculture biologique
L’agriculture biologique émerge dans les années 1920 autour de principes du vivant, du respect des sols et des plantes. Elle se développe réellement à partir des années 1960, en réaction aux dérives de l’agriculture intensive. Une initiative portée par différents collectifs de citoyens, paysans et acteurs du monde de la santé qui décident de créer un cahier des charges qu’ils doivent respecter.
En 1980, les pouvoirs publics français reconnaissent officiellement l’existence d’une « agriculture n’utilisant pas de produits chimiques, ni pesticides de synthèse » dans le cadre de la loi d’orientation agricole, qui est complétée par le décret du 10 mars 1981. Ce sont les premières étapes de l'agriculture biologique en France. En mars 1985, cette forme d’agriculture alternative est officiellement désignée comme « agriculture biologique », et les premières normes de certification sont mises en place. C’est également cette année-là que le logo AB (Agriculture Biologique) fait son apparition, devenant un outil clé pour la visibilité et la crédibilité des produits bio auprès des consommateurs français. Ce label garantit des pratiques sans produits chimiques de synthèse ni OGM, avec un accent mis sur la rotation des cultures et le recyclage de la matière organique, qui sont des éléments essentiels pour préserver la biodiversité et la qualité des sols.
L’uniformisation du bio en Europe
En 2001, un engagement est pris pour uniformiser les règles du bio à l’échelle européenne, aboutissant en 2009 à l’introduction du label européen Eurofeuille. Ce logo vert, avec sa feuille étoilée, est désormais reconnu comme le label officiel de l’agriculture biologique dans l’Union européenne.
Depuis le logo AB français, a été remplacé par le logo bio européen. Bien qu’il soit voué à disparaître progressivement, il reste aujourd’hui plus connu et plus reconnu que le logo européen auprès des consommateurs français.

Bio français, bio espagnol : même combat
Quand on parle de bio, il est tentant de comparer les origines, d’opposer le "bon bio français" au "bio espagnol douteux". Mais en réalité, ils répondent aux mêmes exigences du label bio européen : pas de pesticides de synthèse, pas d’OGM, pas d’engrais chimiques, … Sur le fond, le bio espagnol est bien du vrai bio. Et c’est déjà une avancée majeure par rapport à l’agriculture conventionnelle.
Deux contextes, deux modèles agricoles
Si les règles sont les mêmes, les contextes de production, eux, diffèrent.
- En Espagne, le bio s’est développé dans une logique d’exportation, avec des exploitations souvent plus grandes, parfois plus industrielles, notamment dans des zones comme Almería. Cela n’enlève rien à leur certification : ces produits sont bio.
- En France, le bio est plus souvent ancré dans des démarches locales, souvent plus proches des valeurs de l’agroécologie : respect des saisons, rotation des cultures, gestion durable des sols.
Ces différences expliquent certaines tensions, mais elles ne remettent pas en question la valeur environnementale du bio espagnol. C’est important de le dire : le bio espagnol, tout comme le bio français peuvent être produits sous serre, hors saison, et dans des conditions sociales critiquables. Même si le bio n’est pas parfait, il reste infiniment préférable à l’agriculture conventionnelle.
Vers un bio plus exigeant
Le cahier des charges européen constitue un socle commun essentiel pour structurer le marché du bio à l’échelle de l’Union européenne et offrir aux consommateurs des repères fiables. Le bio, même avec ses imperfections, reste un levier de changement fondamental. Qu'il soit français, espagnol ou plus largement européen : moins d’intrants, plus de respect des écosystèmes, une approche plus douce des ressources.
Si le bio défend une agriculture respectueuse de l’environnement, la concurrence déloyale pousse certains producteurs à adopter des pratiques discutables, comme la culture sous serre chauffée pour produire hors saison et rester compétitifs.
L’interdiction de vendre des légumes bio hors saison, envisagée pour encadrer ces dérives, a été annulée en 2023, accentuant les tensions dans la filière. De ce fait, le label bio européen n’interdit pas la culture sous serre chauffée ni les importations lointaines. Des compromis ont été trouvés tel que la nouvelle réglementation datant de janvier 2025 : “en maraîchage bio, les serres ne pourront être chauffées qu’avec des énergies renouvelables. La vente de légumes produits sous serre chauffée n’est autorisée qu’à partir du 1er Mai.” Ces produits restent préférables au conventionnel, mais le vrai progrès passe aussi par le respect des saisons et une production plus locale.
Il est possible d’établir une hiérarchie claire des choix alimentaires les plus cohérents. En premier lieu, il faut privilégier le bio français de saison, qui combine faible impact carbone, ancrage local et pratiques souvent plus poussées. En deuxième choix vient le bio européen de saison, y compris espagnol, qui reste très satisfaisant du point de vue environnemental. En dernier recours, le conventionnel français de saison, qui reste préférable au hors-saison, mais ne répond pas aux exigences écologiques de long terme.
Il est temps de défendre un modèle agricole européen réellement cohérent. Un bio plus exigeant, plus juste, plus respectueux des écosystèmes, des saisons et des travailleurs. Dans ce contexte, les labels privés émergent comme des outils complémentaires. Des labels comme Nature et Progrès, Bio étiquable ou encore Demeter en France, ou d’autres en Espagne, imposent des critères plus stricts, notamment en matière de conditions de travail, de respect des saisons, ou de biodiversité. Ces démarches tentent de réconcilier les attentes des consommateurs avec les valeurs fondamentales de l’agriculture biologique : respect de la nature, éthique sociale, durabilité.
Sources :
https://www.agencebio.org/decouvrir-le-bio/quest-ce-que-lagriculture-biologique/
https://industriel.net/la-verite-sur-le-bio-espagnol-et-francais-au-dela-des-idees-recues/
https://blog.lafourche.fr/label-bio-engagements-la-fourche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_bio_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=36;lang=ca_ES
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000310810/
Associated resources (for subscribed professionals)
Impact subscribers have access to a catalog of educational resources for understanding sustainable food issues and implementing environmentally responsible practices.