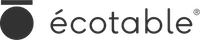Rencontre avec Didier Gascuel, spécialiste en biologie marine qui plaide pour la pêchécologie

Les Français consomment en moyenne 34 kg de produits de la mer par personne chaque année: 24kg issus de la pêche et 10kg de l’aquaculture. Pourtant, pour respecter ce que l’océan peut durablement offrir à chacun sur terre, il faudrait que les Français divisent leur consommation par trois, soit ne pas dépasser 8 kilos de produits de la mer par personne par an. Par ailleurs, la santé des écosystèmes marins dépend en grande partie des méthodes de pêche. Aujourd’hui, la France est la deuxième flotte de pêche européenne en termes de volume de navires. Or, cette pêche industrielle est la première cause d’érosion de la biodiversité marine selon l’IPBES. On pêche trop de poissons, avec des méthodes délétères, trop loin, trop profond. Ce qui a par ailleurs aussi des conséquences sociales fortes car aujourd’hui, ce sont 3 milliards d’humains qui dépendent de la mer et de ses ressources. Alors quel est l'état des lieux de la pêche aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'une pêche vraiment durable ?
Du 9 au 13 juin 2025 s’est tenu à Nice le troisième sommet sur les océans (UNOC3), organisé par les Nations Unies à Nice. L'occasion pour nous de faire un point sur la pêche avec l’un des plus grands experts de ce sujet en France : Didier Gascuel.
Didier Gascuel est professeur en écologie marine à l'Institut Agro a Rennes et ancien membre du Conseil scientifique des pêches de l'UE. Il a publié en 2023 un ouvrage nommé La pêchécologie, manifeste pour une pêche vraiment durable, qui plaide notamment pour une vision des ressources aquatiques comme un bien commun de l’humanité, où chaque poisson pêché a un faible impact environnemental et une grande utilité sociétale.
Comment vont les océans ?
Globalement, les océans ne vont pas bien. Je dirais même qu’il y a le feu à l'océan. Aujourd'hui, les impacts les plus importants sont clairement ceux issus de la pêche.
Depuis, le XXe siècle, où la pêche industrielle s’est généralisée, et on a littéralement vidé la mer d'une grande partie de ses poissons. On estime que l'abondance des poissons qu'on exploite a été divisée au moins par cinq, et par dix, voire par 50 ou 100, pour les grandes espèces, les grands prédateurs et les espèces les plus pêchées. Il y a très peu d'extinction d’espèces par la pêche. Par contre, les populations tombent à des niveaux très faibles dans lesquels elles ne peuvent plus ni jouer leur rôle dans l'écosystème. On parle de perte de biodiversité fonctionnelle.
On a aussi impacté les fonds marins, en particulier avec le chalut de fond qui s'est généralisé et qui a détruit une partie de la productivité des océans. La machine océanique fonctionne avec deux “moteurs”. Un “moteur” qu'on appelle la production primaire, c'est-à-dire la production du phytoplancton en surface, responsable de la photosynthèse et à la base d'une partie des chaînes alimentaires. L’'autre “moteur”, c'est la régénération de la matière vivante quand elle tombe morte au fond de l'océan, qui est l’autre base des chaînes alimentaires aquatiques.
La pêche a donc, d'une certaine manière, scié la branche sur laquelle elle était assise. Petit à petit, on a changé la structure et le fonctionnement de l'écosystème marin. On se retrouve donc aujourd'hui avec des écosystèmes à faible productivité, qui sont de plus en plus instables à cause des dysfonctionnements majeurs liés à l'érosion de la biodiversité et liés à l'impact de la pêche.
"La pêche, c'est aussi de la valeur culturelle, du patrimoine, de l'histoire, des rêves...c'est aussi le club de foot, l'amicale des anciens: en réalité, la pêche fait la résilience de nombreux territoires."
Qu’est-ce qu’une pêche durable ?
La pêche durable, c'est surtout de penser les choses à l'échelle de l'écosystème. Moi, j'appartiens à un courant de pensée selon lequel aujourd'hui, il faut complètement repenser les questions de durabilité des pêches, pour passer à ce qu’on appelle la “pêchécologie”. Ce mot, c'est l'analogie en milieu marin de l'agroécologie.
Dans l'absolu, si on pouvait pêcher sans aucun impact, ça serait parfait, mais ce n'est pas possible. Les ressources de la mer, et de la nature en général, ce sont des biens communs. Ce qui signifie que si nous les prélevons, ils doivent bénéficier au plus grand nombre, selon des choix collectifs. Il n'est pas normal que les dividendes qu'on tire des ressources de la mer soient capturés par un petit nombre de grands armements industriels, alors qu'ils pourraient bénéficier au plus grand nombre. Chaque kilo de poisson qu'on retire de la mer, c'est aussi de l'emploi, de la richesse créée. Je dis souvent que la pêche durable prend en compte le coiffeur, l'instituteur, le garagiste qui vit dans le bourg de pêcheurs. Et cela va encore plus loin. La pêche durable, c'est de la valeur culturelle, c'est du patrimoine, c'est de l'histoire, c'est des rêves, c'est aussi le club de foot, l'amicale des anciens, en réalité, la pêche c'est la résilience de nombreux territoires. Donc une pêche durable, c'est minimiser les impacts, maximiser l'utilité sociale et sociétale de ce que nous offre la nature.
Ce qui fait qu'une pêche est plus ou moins durable, c'est surtout l'engin de pêche. Il y a une très très grande diversité des engins, mais les deux grandes catégories sont les engins traînants et les engins dormants. Comme le nom l'indique, les premiers sont traînés derrière le bateau. Il faut bien distinguer les chaluts de fond, qui comme le nom l'indique, vont traîner sur le fond et vont avoir énormément d'impact sur l’écosystème, et les chaluts de pleine eau, ou de surface. Du point de vue environnemental, et à condition de ne pas trop prélever, ce sont des engins plutôt vertueux. Les seconds sont les engins dormants, ou passifs. Là où on compte sur le comportement du poisson pour venir se prendre sur ou dans l'engin : ce sont les nasses et les casiers, et la ligne. Ces engins-là sont a priori peu impactants sur le milieu.

Qu’en est-il de l’aquaculture ?
L’aquaculture, c’est la version aquatique d'une agriculture productiviste de plus en plus intensifiée, avec de plus en plus d'intrants, de plus en plus impactantes, qu'on imagine complètement coupée des écosystèmes naturels. En France, l'aquaculture concerne essentiellement le saumon, et un peu la truite, le bar et la dorade. Toutes ces espèces sont piscivores, c'est-à-dire que leur alimentation repose sur d’autres poissons, ou de la farine de poisson dans le cas des élevages. Donc, on va en mer, on prélève des ressources, on en fait de la farine qu’on donne à manger à d’autres poissons. Vous voyez venir le problème ?
"Le saumon a de la misère humaine dans sa chair et il faut en être conscient."
Le pire dans tout ça, c'est que ces poissons, on va les chercher dans les pays du Sud. J'ai travaillé en Afrique de l'Ouest, où j’ai été témoin des ravages de ces grands bateaux industriels, qui pillent littéralement les ressources locales pour donner à manger au saumon des riches. Pire encore, aujourd’hui ce sont directement les pêcheurs artisans, en particulier au Sénégal, qui vont exploiter ces petits poissons pélagiques et fourrage pour les livrer directement à l'usine de farine de poisson. Résultat ? Les locaux ne mangent quasiment plus de poisson. C’était plusieurs millions de tonnes de poissons qui alimentaient avant le marché africain et qui faisaient l'alimentation de toute l'Afrique de l'Ouest, et qui, aujourd'hui, viennent nourrir les poissons des riches. Derrière, il y avait aussi tout un secteur tenu par les femmes, qui valorisaient le poisson, faisaient du séchage, du fumage, du commerce de poissons, et qui se retrouvent aujourd'hui complètement dans la misère. Avec l’aquaculture se joue donc un réel drame social. L'agriculture, c'est un problème d'écologie, mais pour moi, c'est avant tout un problème d'équité et d’éthique. Le saumon a de la misère humaine dans sa chair et il faut en être conscient. Et ceux qui défendent l'aquaculture vous diront qu’ils remplacent de plus en plus la farine de poisson par du soja. Donc déforester des forêts pour faire du soja, pour le donner aux saumons…c'est pas génial non plus comme argument.
À l'inverse, il existe tout de même quelques formes d'aquaculture qui peuvent être durables. D'abord, il y a les huîtres et les moules qui ont globalement un bon bilan environnemental, car elles se nourrissent directement dans le milieu, elles filtrent le plancton. Au passage, elles font aussi de la captation de carbone. Et puis, souvent, ce sont des petits producteurs. Ça fait vivre du monde, ça crée de la richesse,etc. L’autre aquaculture qui peut être vertueuse, ce sont les algues. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, donc toutes les raisons de développer leur consommation. Enfin, il existe aussi des poissons herbivores. Par exemple, aux Etats-Unis, on mange beaucoup de poisson chat. Il se nourrit essentiellement de débris végétaux, voire mange des restes alimentaires.
→ Pour en apprendre plus sur les impacts de la pêche industrielle et les solutions proposées par les experts comme la pêchécologie, écoutez son passage dans le podcast Sur le Grill d'Écotable, épisode « #110 - La pêchécologie est-elle la solution? Avec Didier Gascuel »
Crédit photo : euradio.fr / Knut Troim
Ressources associées (accès abonnés)
Les abonnés Impact ont accès à un catalogue de ressources pédagogiques pour pour comprendre les enjeux liés à l'alimentation durable et mettre en oeuvre des pratiques écoresponsables.